Deirdre Bair, « Jung », Coll. « Grandes biographies », Editions Flammarion, 2008, 1312 p., 39 euros.
Si l’histoire -et les historiens- de la psychanalyse les opposent résolument, un point commun réunit cependant Sigmund Freud et Carl Gustav Jung : la difficulté d’écrire leur biographie. En dépit du travail considérable d’Ernest Jones, le fondateur viennois de la psychanalyse se plaisait à expliquer à son proche entourage qu’il ne « faciliterait pas la tâche de ses biographes ». Entre les lettres et les documents brûlés volontairement dès le commencement de sa vie professionnelle et les autres correspondances qui devront attendre le siècle prochain pour être accessibles au public, Freud -et ses descendants- pavèrent en quelque sorte la voie à Carl Gustav Jung. Ce dernier rejeta en effet plusieurs propositions destinées à rendre compte de son œuvre. Personne n’était capable, selon lui, de produire cette « synthèse psychologique » reposant sur des « connaissances égales aux siennes » en psychologie primitive, en mythologie, en histoire, en parapsychologie et en sciences. Il convient donc de saluer l’immense travail accompli par Deirdre Bair, ancienne Professeur aux Universités Yale et Columbia, pour sa minutieuse étude biographique -plus de mille pages !- sur la vie et les travaux de « Jung ». Parue aux éditions Flammarion, cette recherche s’impose non seulement en raison de son caractère fouillé mais également parce qu’elle a su, sans jamais les perdre complètement de vue, quitter les rivages balisés et reconnus du freudisme pour s’imprégner de l’univers plus ésotérique du psychiatre suisse.
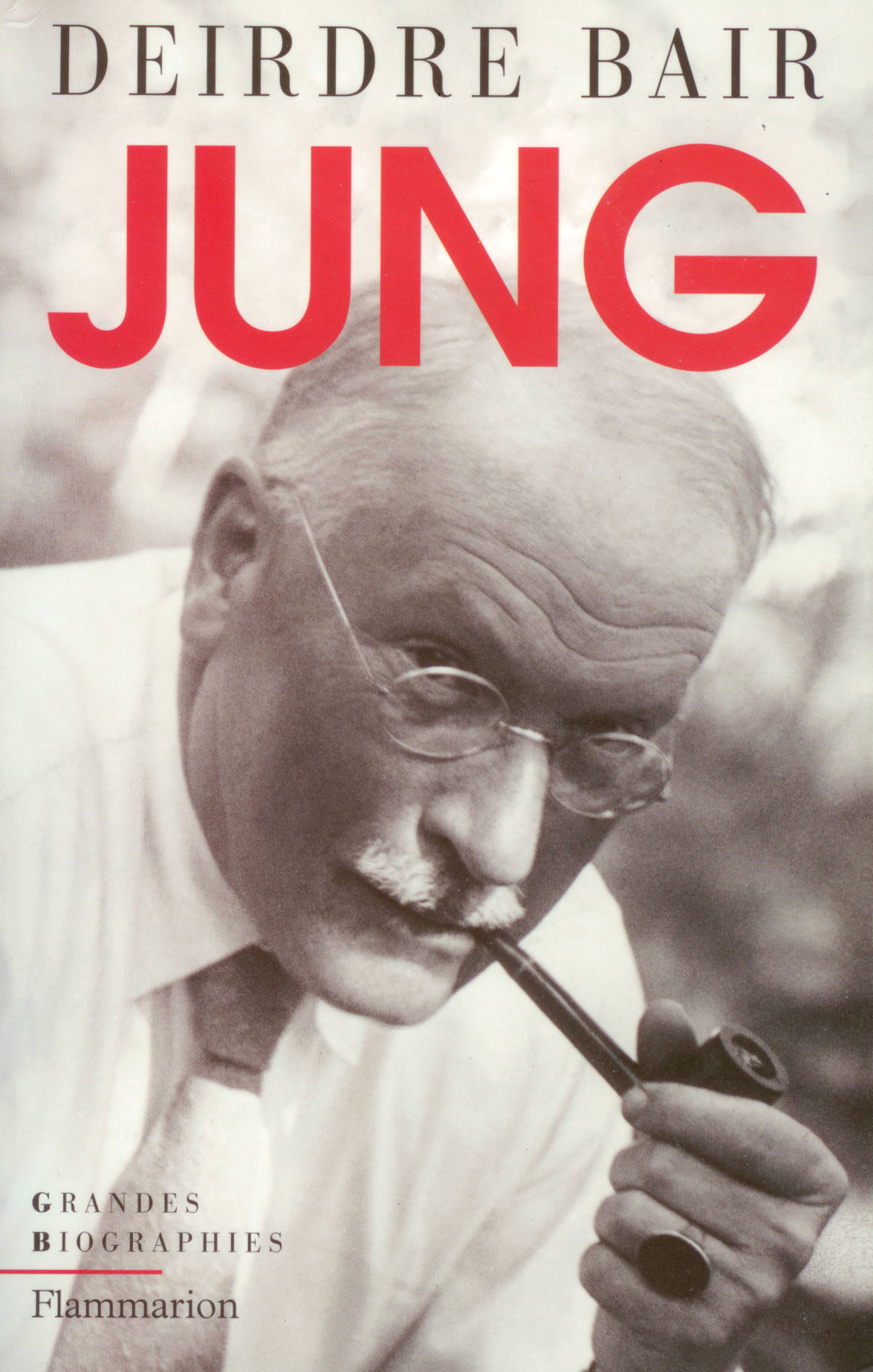
Un mythe qui commence en quelque sorte à la naissance du personnage puisque des quatre enfants du « modeste pasteur suisse » et d’une épouse « tourmentée et malheureuse », nous dit Deirdre Bair, Jung sera dans un premier temps l’unique survivant. Mythe abondamment abreuvé de fantômes : dans sa belle famille, Samuel Preiszwerk, considéré comme un « précurseur du sionisme », conservait dans son bureau un fauteuil dédié à l’esprit de son épouse défunte Magdalena avec lequel il s’entretenait régulièrement. Quant à ses cousines, encouragées par sa mère, elles organisaient des séances de spiritisme auxquelles Jung participait lorsqu’il ne prenait pas une part active à celles planifiées par certains des membres de la société des « Zofinguiens », sa confrérie étudiante. D’où une interrogation générale susceptible d’être partagée avec la biographe : lorsque Jung affirmera sur la fin de sa vie qu’il doit son choix de la psychiatrie à la lecture du « Psychopathia sexualis » de Krafft-Ebing, le rapport permanent avec son mysticisme n’en paraît que plus indéchiffrable. Sauf à l’éclairer, comme le fait l’auteur, de deux « événements mystérieux » datant de son premier semestre à la Faculté de médecine : une table en noyer qui se fend soudainement jusqu’au milieu et, quelques semaines plus tard, une lame de couteau retrouvée dans un tiroir « anormalement » brisée en plusieurs morceaux. Jung débute alors ses recherches sur les expériences paranormales qui le conduisent aux « pouvoirs de l’esprit » et aux « phénomènes psychiques objectifs ».
Doté d’une robuste constitution physique et de possibilités intellectuelles « hors du commun », explique l’auteur, Carl Gustav Jung expérimente très tôt sur lui-même les capacités offertes par la psychologie humaine : syncopes adolescentes qu’il parviendra à maîtriser, découverte de ce qu’il nomme, pour chaque individu, les personnalités n°1 et n°2, élaboration du concept de « synchronicité » -avec pour parrain avoué Schopenhauer- ou encore intégration des mythes individuel et collectif dans les remaniements psychiques, autant de « moments clés dans son existence » confiera-t-il plus tard. Nonobstant ces expériences aussi personnelles que formatrices, le futur praticien de la clinique psychiatrique de l’Université de Zurich, le célèbre Burghölzli, n’en apprend pas moins à « intégrer dans ses études » sa connaissance des autres disciplines » : mythologie, anthropologie culturelle et étude comparative des religions au travers de lectures aussi antagonistes que celles des « rêves d’un visionnaire » de Kant ou celles « des Indes à la planète Mars » de Théodore Flournoy. Plus qu’une authentique méthode de travail -le manque de didactisme se fait sentir dans pratiquement tous ses écrits- c’est une véritable passion, une soif inextinguible de compréhension des ressorts cachés de l’âme humaine qui le pousse toute sa vie à voyager dans les contrées les plus inaccessibles pour l’époque : infatigable visiteur des Etats-Unis, il entreprend également, à partir de la Tunisie, un périple non dénué de dangers qui le mène au cœur du Continent noir, un « point de repère hors de sa propre civilisation » avant, par surcroît, de séjourner en Inde où la « question du mal » monopolisera en grande partie son « attention ».
Ce n’est pas, en outre, le moindre des mérites de cette étude que celui d’insister sur l’environnement politique et culturel dans lequel le futur créateur de la « psychologie analytique », issu d’un milieu modeste, pour ne pas dire socialement marginalisé, accomplit une ascension professionnelle fulgurante. Pour le dire autrement, si Jung, « le Carl du Pasteur », un théologien « bâlois », n’est pas vraiment « né » suisse, il l’est parfaitement devenu à la fin de sa vie. Micro société avec ses règles et ses privilèges, la Suisse dont « l’attitude à l’égard des étrangers n’était à l’époque guère louable » assure l’universitaire américaine, reste un monde à part dont Jung a su habilement transformer les multiples inconvénients en avantages incomparables. Sa notoriété tient lieu de revanche. Elle lui coûtera aussi les méfaits d’une auréole sérieusement entamée pour ses sympathies alambiquées envers les nazis.
De cette riche saga jungienne déroulée avec professionnalisme par Deirdre Bair, trois dossiers retiendront plus précisément l’attention du lecteur : ses relations avec les femmes, sa rupture avec Freud et ses compromissions pour le moins « embarrassantes » avec le nazisme.
Si l’auteur intitule un de ses chapitres « timidement correct avec les femmes », elle ne lésine pourtant pas sur les détails qui montrent à l’évidence un C.G. Jung avide de séduire et généreusement entourée d’une gente féminine variée et enthousiaste : bourgeoises ou aristocrates entichées du « Professeur », intellectuelles ou femmes « sensibles à la psychologie » susceptibles, en outre, de l’aider dans ses recherches. Faut-il forcément y déceler un reflet de ses inquiétudes sur les amitiés masculines, avec, pour origine, une agression à caractère sexuel de la part d’un prêtre dans sa prime enfance ? En tout cas Jung ne reniera jamais cette proximité. Au point de contraindre son épouse, pourtant riche héritière qui lui procure son aisance financière, à « un ménage à trois » avec Toni Wolff, compagne associée à nombre de ses travaux. Liaison précédée d’une relation plus tumultueuse avec Sabina Spielrein à laquelle on doit les premières élaborations, développées ultérieurement par Freud, sur les pulsions de mort. On notera également sa rencontre au cœur de l’Afrique noire avec Ruth Bailey, devenue une fidèle amie de la famille et qui l’accompagnera, après la disparition de son épouse Emma, jusqu’à son dernier souffle.
Dans sa relation à Freud, l’entrée en matière est connue : le dimanche 3 mars 1907, Jung pénètre -à 10h00 selon les Freudiens, à 13h00 selon les Jungiens !- au 19 de la Berggasse et s’entretient avec le fondateur de la psychanalyse pendant treize heures d’affilée. Toujours est-il que dès le 7 avril suivant, le Viennois écrit au Zurichois qu’après cette rencontre, il « sait qu’il est remplaçable au même titre que n’importe quel homme ». Jung évoque pour sa part « un moment hors du temps ». Au-delà des querelles d’horaires, la relation est, semble-t-il, mal engagée dès le départ : Deirdre Bair insiste non seulement sur la rivalité de Jung avec son chef Bleuler, mue par le souci d’un rapport exclusif avec le père de la psychanalyse et qui serait à l’origine de la démarche du jeune psychiatre suisse. Par surcroît, la première discussion met immédiatement à jour le fossé entre les deux hommes : Jung regrette les « préjugés matérialistes » sur la parapsychologie de Freud lequel demeure avant tout en quête d’un « chrétien, à même d’empêcher », comme il l’écrira à K. Abraham dans une lettre du 3 mai 1908, de faire de la psychanalyse une « affaire de la nation juive ». Dans ces conditions, le « geste de Kreuzlingen » de mai 1912, une visite de Freud à un collègue mourant dans les environs de Zürich et une lettre -jamais partie, jamais arrivée ou jamais lue ?- censée avertir Jung, consacrent l’antagonisme des deux hommes. Comme « l’huile et l’eau », écrira Freud. « On rend mal son dû à un maître quand on reste toujours l’élève », ponctuera de son côté Jung en s’appuyant sur une citation de Nietzsche.
Reste la question la plus épineuse : affilié à une société allemande médicale de psychothérapie jusqu’à la veille de la guerre, Jung est-il crédible lorsqu’il prétend, dans sa position de président international nommé en juin 1933, avoir été en mesure d’aider les analystes juifs allemands privés de leur droit ? Pour la première fois, note Deirdre Bair, Jung entre « en collision avec l’histoire ». L’auteur prend un soin méticuleux à présenter les arguments à charge et à décharge. Les premiers en nombre toutefois plus conséquent que les seconds. De l’essai controversé de 1918 « De l’inconscient », ses détracteurs ne veulent retenir que les parties les plus accablantes par leur antisémitisme. Impressions étayées, il est vrai, par divers courriers rédigés à partir de 1934 où il reconnaît « les frontières politiques même en science » et par des relations suivies avec l’analyste Matthias Göring, frère du tristement célèbre Hermann. D’un autre côté, Jung, précise l’auteur, ne fait que suivre les recommandations de son ancien mentor : « en dépit du contrôle de l’Institut psychanalytique de Berlin par la fraction nazie », écrit Freud à Eitington à la même époque, il est dans « l’intérêt général de la psychanalyse de le garder ouvert afin de lui permettre de survivre à ces temps difficiles ». Jung se bat -certes bien tardivement- en 1938 pour obtenir des nazis que le Congrès de psychanalyse se tienne à Oxford et ne démissionne -ou selon ses partisans, n’obtient de Göring sa démission à force de la lui réclamer- qu’en juillet 1940, alors que le conflit a déjà commencé. Jung de son vivant, et après lui ses descendants, traînent encore aujourd’hui les conséquences de cette réputation passablement ternie.
« Ma vie est l’histoire d’un inconscient qui a accompli sa réalisation » écrit-il au seuil de la mort. Lorsqu’il commence, à plus de quatre-vingt ans, à rassembler ses souvenirs, Carl Gustav Jung, le « passionné du mythe collectif », ignore-t-il que son œuvre, adulée ou critiquée, appartient finalement davantage à l’univers constellé de la psychanalyse qu’à son noyau dur ? Entre la clinique du Burghölzli et sa tour de Bollingen, C.G. Jung a tenté -ambition démesurée ?- de cerner la psyché du monde. Travail acharné, abondant, souvent désordonné mais fondamentalement vivant. Au risque de toutes les incompréhensions et de toutes les interprétations.
Nice, le 26 avril 2008
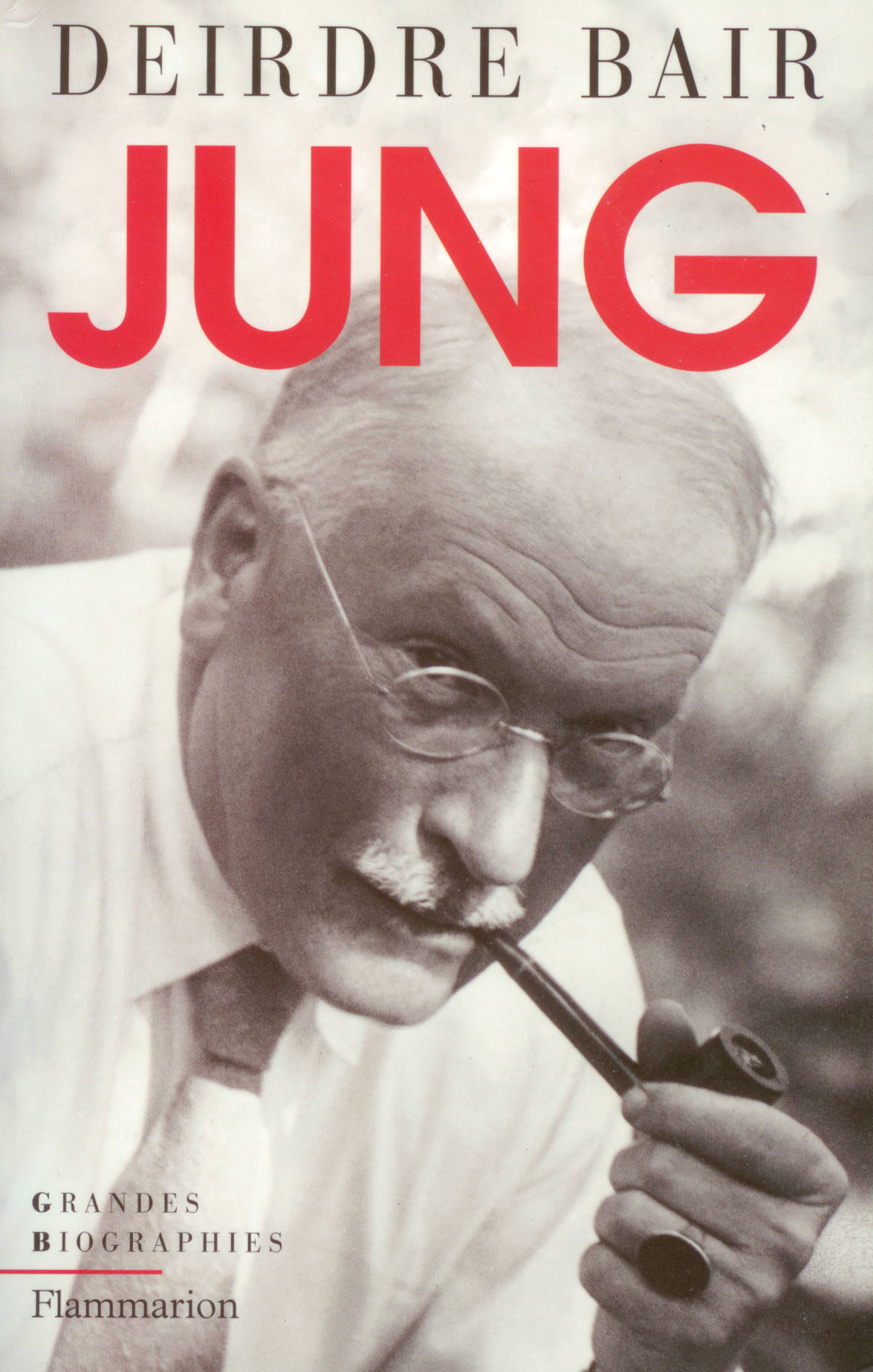 Un mythe qui commence en quelque sorte à la naissance du personnage puisque des quatre enfants du « modeste pasteur suisse » et d’une épouse « tourmentée et malheureuse », nous dit Deirdre Bair, Jung sera dans un premier temps l’unique survivant. Mythe abondamment abreuvé de fantômes : dans sa belle famille, Samuel Preiszwerk, considéré comme un « précurseur du sionisme », conservait dans son bureau un fauteuil dédié à l’esprit de son épouse défunte Magdalena avec lequel il s’entretenait régulièrement. Quant à ses cousines, encouragées par sa mère, elles organisaient des séances de spiritisme auxquelles Jung participait lorsqu’il ne prenait pas une part active à celles planifiées par certains des membres de la société des « Zofinguiens », sa confrérie étudiante. D’où une interrogation générale susceptible d’être partagée avec la biographe : lorsque Jung affirmera sur la fin de sa vie qu’il doit son choix de la psychiatrie à la lecture du « Psychopathia sexualis » de Krafft-Ebing, le rapport permanent avec son mysticisme n’en paraît que plus indéchiffrable. Sauf à l’éclairer, comme le fait l’auteur, de deux « événements mystérieux » datant de son premier semestre à la Faculté de médecine : une table en noyer qui se fend soudainement jusqu’au milieu et, quelques semaines plus tard, une lame de couteau retrouvée dans un tiroir « anormalement » brisée en plusieurs morceaux. Jung débute alors ses recherches sur les expériences paranormales qui le conduisent aux « pouvoirs de l’esprit » et aux « phénomènes psychiques objectifs ».
Un mythe qui commence en quelque sorte à la naissance du personnage puisque des quatre enfants du « modeste pasteur suisse » et d’une épouse « tourmentée et malheureuse », nous dit Deirdre Bair, Jung sera dans un premier temps l’unique survivant. Mythe abondamment abreuvé de fantômes : dans sa belle famille, Samuel Preiszwerk, considéré comme un « précurseur du sionisme », conservait dans son bureau un fauteuil dédié à l’esprit de son épouse défunte Magdalena avec lequel il s’entretenait régulièrement. Quant à ses cousines, encouragées par sa mère, elles organisaient des séances de spiritisme auxquelles Jung participait lorsqu’il ne prenait pas une part active à celles planifiées par certains des membres de la société des « Zofinguiens », sa confrérie étudiante. D’où une interrogation générale susceptible d’être partagée avec la biographe : lorsque Jung affirmera sur la fin de sa vie qu’il doit son choix de la psychiatrie à la lecture du « Psychopathia sexualis » de Krafft-Ebing, le rapport permanent avec son mysticisme n’en paraît que plus indéchiffrable. Sauf à l’éclairer, comme le fait l’auteur, de deux « événements mystérieux » datant de son premier semestre à la Faculté de médecine : une table en noyer qui se fend soudainement jusqu’au milieu et, quelques semaines plus tard, une lame de couteau retrouvée dans un tiroir « anormalement » brisée en plusieurs morceaux. Jung débute alors ses recherches sur les expériences paranormales qui le conduisent aux « pouvoirs de l’esprit » et aux « phénomènes psychiques objectifs ».
