« Winnicott, sa vie, son œuvre », par F. Robert Rodman (Editions Eres, 2008)
Il incarne par excellence la troisième voie. Celle de la psychanalyse pure et dure, serait-on tenté d’écrire, tellement cette difficulté de choisir, cette préférence pour le va-et-vient permanent d’une pensée qui refuserait de s’ancrer définitivement au risque de se figer, correspond à la posture scientifique freudienne. Celle-ci n’hésitait jamais à se remettre en cause à partir des expériences cliniques sur lesquelles elle s’étayait.
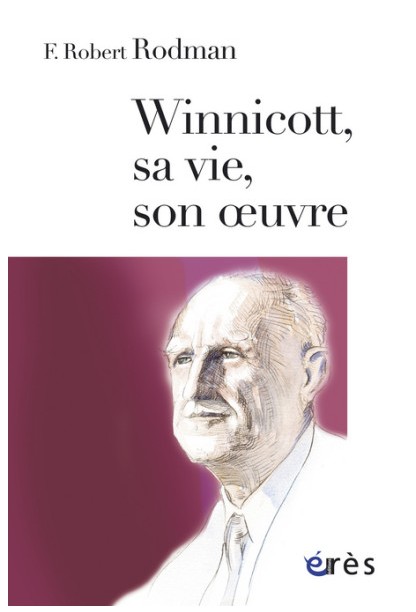
Dans le grand héritage freudien anglo-saxon que se partageaient, sinon se déchiraient, Mélanie Klein et Anna Freud, Donald Woods Winnicott ne se résolut jamais à suivre complètement la première sans pour autant parvenir à rejoindre une fois pour toutes la seconde. C’est néanmoins cette histoire alambiquée des raisons et des aléas de ce glissement progressif, de l’une vers l’autre, que nous relate F. Robert Rodman dans la très instructive et très éclairante biographie consacrée à ce psychanalyste hors du commun.
La première de ces raisons, véritable fil d’Ariane de l’ouvrage, réside dans la densité et la complexité du personnage lui-même. Le créateur du « Squiggle », probablement l’un des plus célèbres jeux dédiés à la clinique d’enfant, ne cessa jamais, comme il se doit, son travail d’autoanalyse. Il puisa dans certaines de ses interrogations les plus intimes, les plus enfouies, d’incessantes et d’ingénieuses élaborations créatives qui le conduisirent à formuler et à proposer des concepts à la fois novateurs et performants pour la clinique : le « vrai et faux self », la « mère suffisamment bonne », le « Holding » et le « Handling », « l’objet transitionnel », pour ne citer que les plus connus, appartiennent aux outils dont la psychanalyse aurait bien du mal à se passer aujourd’hui.
La première de ces raisons, véritable fil d’Ariane de l’ouvrage, réside dans la densité et la complexité du personnage lui-même. Le créateur du « Squiggle », probablement l’un des plus célèbres jeux dédiés à la clinique d’enfant, ne cessa jamais, comme il se doit, son travail d’autoanalyse. Il puisa dans certaines de ses interrogations les plus intimes, les plus enfouies, d’incessantes et d’ingénieuses élaborations créatives qui le conduisirent à formuler et à proposer des concepts à la fois novateurs et performants pour la clinique : le « vrai et faux self », la « mère suffisamment bonne », le « Holding » et le « Handling », « l’objet transitionnel », pour ne citer que les plus connus, appartiennent aux outils dont la psychanalyse aurait bien du mal à se passer aujourd’hui.
Justifier cette lente évolution par opportunisme -Winnicott se rapprocha de Anna Freud à la mort de Mélanie Klein- sied mal à celui qui modifia pour la Grande-Bretagne, à l’image du travail accompli par Françoise Dolto en France, la clinique du couple et celle de la mère et de l’enfant : il reçut en effet plus de 60 000 d’entre eux au cours de sa longue carrière, estime l’auteur. Ce glissement trahit toutefois, selon lui, son besoin aussi implicite qu’inaltérable d’obtenir une « reconnaissance » de ses travaux par une puissante figure maternelle. Voire de rechercher une forme d’attachement dans une acception pas très éloignée de celle formulée par Wilfred Bion. Son ambivalence envers Mélanie Klein jusqu’à la rupture, jamais complètement consommée, contenue dans sa lettre du 17 novembre 1952 où il lui reprochait la fixation dogmatique de sa pensée doublée d’un métalangage réservé à ses adeptes, ainsi que son approche tout aussi ambiguë, hésitante, en direction de la descendante du père de la psychanalyse, signent le particularisme de son propre cheminement. Un entre-deux tellement revendiqué qu’il fut amené, en juin 1954, à proposer aux deux protagonistes de « dissoudre l’organisation à la base du programme de formation ».
Certains de ses détracteurs voudront y déceler les vicissitudes de son parcours sur le divan. En analyse avec James Strachey, patient de Freud, il effectua une « seconde tranche » avec Joan Rivière, la première analyste « profane » en Angleterre. Avec, en toile de fond, une sorte de « deal » qui le lia irrévocablement à Mélanie Klein dans un transfert latéral et croisé : elle lui demanda de renoncer à faire une analyse avec elle pour qu’il puisse traiter son propre fils Eric. Il la sollicita néanmoins ultérieurement pour qu’elle accepte de recevoir en analyse sa seconde épouse. On peut faire plus simple.
D.W. Winnicott, dont le portrait dressé par F. Robert Rodman se veut toujours bienveillant, n’en finit pas, semble-t-il, de solder ses comptes avec sa mère. Si celle-ci fut apparemment tenue pour responsable d’un sevrage précoce et traumatisant car elle ne « supportait pas sa propre excitation pendant l’allaitement », elle amena chez Winnicott l’idée que la mère demeure une « figure réelle, cruciale pour le développement de l’enfant ». Principe fondamentalement rejeté par Mélanie Klein.
Winnicott allait d’ailleurs expérimenter sur lui-même les conséquences de cette rupture originelle sous la forme conceptualisée du « contact humain avec la réalité extérieure » : c’est probablement en écho à celle-ci qu’il en vint à se séparer de sa première femme. Une séparation qui intervint après une « thrombose coronarienne », elle-même consécutive à la mort de son père. Constante jusqu’à son dernier souffle, l’évolution de D.W. Winnicott lui fit aborder vers la fin de sa vie des rivages jungiens avec « l’Arbre », poème publié en novembre 1963 qui traite « de son assujettissement à une mère dépressive » dans une approche où la dimension christique le dispute à la relation maternelle inconsciente.
Finalement, c’est la psychanalyste Pearl King, citée par l’auteur, qui semble le mieux définir Winnicott en le décrivant comme « le cavalier au jeu d’échecs » : « ses déplacements étaient exceptionnels, imprévisibles, obliques »./.
Nice, le 17 mars 2009

